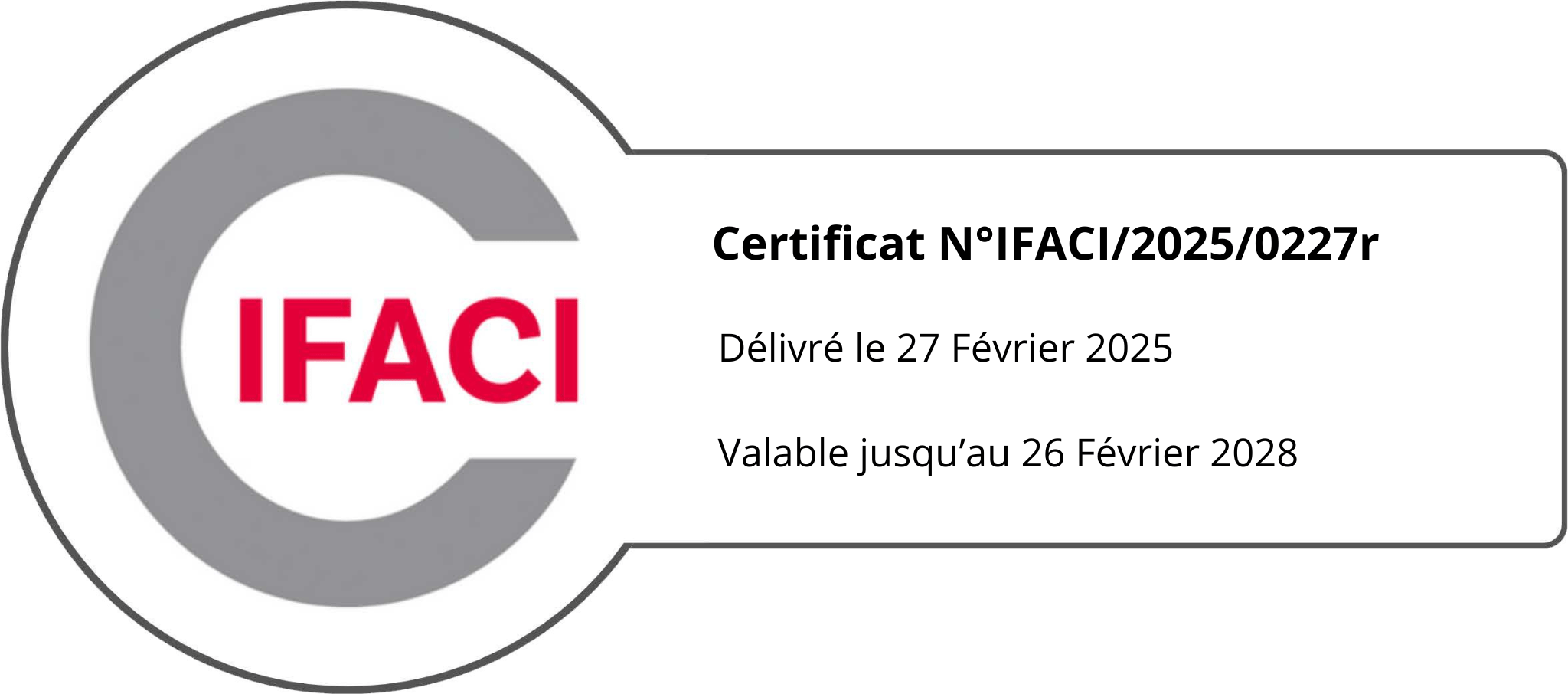- Permettre une mobilité durable des personnes et des biens à l’intérieur et entre les pays membres de l’UEMOA par le développement des infrastructures et la prise en compte de l’environnement et de la résilience
- Développer différents modes de transport afin d’abaisser les coûts et offrir davantage de choix aux usagers
- Favoriser l’accès des populations aux solutions de télécommunications
- Adapter les réseaux de télécommunications aux évolutions des technologies (4G/5G)
- Digitaliser les procédures administratives et processus du secteur privé en vue d’améliorer les prestations, gagner du temps et assurer la transparence
Infrastructures et économie numérique
La BOAD est fortement engagée dans les secteurs des infrastructures et de l’économie numérique où elle enregistre 3406,218 milliards FCFA engagés, soit 39,05% de ses engagements globaux, au 30 juin 2024. La BOAD réaffirme cet engagement dans le cadre du plan stratégique 2021-2025, nommé Djoliba, qui prévoit 1 085 milliards FCFA d’investissements supplémentaires dans le secteur. Cela correspond à 35% des engagements globaux de la Banque sur la période 2021-2025.
Nos missions

Notre approche
La BOAD prend part à des projets et programmes alignés à la fois avec les programmes nationaux et son Plan Stratégique Djoliba. Dans le cadre de l’appui apporté aux Etats membres de l’UEMOA, la BOAD fait appel aux acteurs du secteur privé qu’elle implique dans la conception, le financement, la réalisation et l’exploitation d’infrastructures structurantes dans une approche de PPP. Cette approche vise une amplification des financements en vue de combler le déficit infrastructurel, condition sine qua non de l’émergence des pays d’Afrique de l’Ouest.

Nos priorités d'intervention

- Appuyer les Etats et les acteurs du secteur privé dans le financement des études et le montage de projets et programmes nationaux et intégrateurs à fort impact.
- Faire un plaidoyer pour le sous-secteur ferroviaire qui constitue le mode de transport le plus économique et le moins polluant.
- Identifier et appuyer à la préparation des projets climat d’aménagement urbain et de résilience aux chocs.
- Accompagner la création de hubs aéroportuaires dans un esprit de subsidiarité et le déplacement de certains aéroports situés en zones fortement urbanisées, afin d’opérer dans les conditions optimales de sécurité et de sûreté.
- Accompagner les Etats dans la promotion des Champions nationaux.
- Recourir à des financements innovants, notamment pour les infrastructures marchandes (ports, aéroports, chemins de fer, infrastructures routières d’envergure).
Nos réalisations à mi-parcours du plan Djoliba
- 3.8 millionsde passagers aéroportuaires
- 2.6 millionsd’abonnés supplémentaires aux services digitaux
- 7.6 millionsde tonnes de marchandises transportées par fret maritime
Au 30/06/2024, la BOAD a financé 41 projets :
- 2 Projets d’autoroutes
- 18 Projets de routes
- 5 Projets d’assainissement pluvial, d’eaux usées et déchets solides
- 5 Projets d’aménagements urbains
- 1 Projet d’aéroport
- 1 Projet portuaire
- 1 Projet ferroviaire
- 2 Projets de plateformes industrielle / zones économiques spéciales
- 1 Projet de marché
- 2 Projets de télécommunication
- 1 Projet de vidéosurveillance
- 2 Projets de digitalisation
Dans le cadre du Plan Stratégique 2021-2025 Djoliba, la BOAD prévoit un
financement total de 1 085 milliards FCFA pour le secteur des Infrastructures et de
l’Economie Numérique.

Projets emblématiques
Création et exploitation Plateforme Industrielle d’Aditikopé au Togo
Coût projet 83 560 M FCFA :
- BOAD : 20 000 MFCFA (24%)
- Fonds propres (30%) : Capital (17 643 MFCFA) / Comptes courants (7 347 MFCFA)
- Pool Bancaire : 38 570 M FCFA (46%)
Construction plateforme logistique du pôle agroalimentaire du Grand Nokoué à Abomey Calavi au Bénin
Coût 108 912 MFCFA :
- BOAD : 20 000 MFCFA (18%)
- Banques locales : 65 000 MFCFA (60%)
- Etat béninois : 23 912 MFCFA (22%)
Port Sec de Bobo Dioulasso au Burkina Faso
Coût construction + Réhabilitation + Extension = 14 086 MFCFA :
- BOAD : 8 210 MFCFA (58%)
- Banques Locales (BOA et Coris Bank) : 3 786 MFCFA (27%)
- CCI-BF : 2 090 MFCFA (15%)
Pont à Péage Riviera-Marcory (Henri Konan Bédié : HKB) + Echangeur
Valéry Giscard d’Estaing (VGE) à Abidjan en Côte d’Ivoire
Coût 168 040 MFCFA :
- BOAD (14 300 + 20 000) : 34 300 MFCFA (20%)
- Co-bailleurs (BIDC, BID et autres) : 61 585 MFCFA (37%)
- SOCOPRIM : 18 875 MFCFA (11%) et iv) Etat : 53 585 MFCFA (32%).
Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) à Diass au Sénégal
Coût initial 344 246,2 MFCFA :
- BOAD : 17 000 MFCFA (5%)
- Fonds propres SDB : 95 704 MFCFA (28%)
- Co-bailleurs (BAD, BID, AFD, IDC, Fonds OPEP, Fonds saoudien) : 66,98%
- Etat : 56,2 MFCFA (0,02%)
Autoroute de l’Avenir Dakar-Diamniadio-AIBD au Sénégal
Coût projet 677 818 M FCFA :
- BOAD : 53 498 MFCFA (8%)
- Fonds propres : 82 289 MFCFA (12%)
- Autres Bailleurs de fonds (SFI, BAD, CBAO, Société Générale et Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF)) : 224 038 MFCFA (33%)
- Etat : 317 993 MFCFA (47%)
Daouda BERTE

Directeur du Département des Infrastructures et de l’Economie Numérique
Adresse : 68 avenue de la Libération, Lomé, Togo
eMail : dberte@boad.org
Téléphone : +228 22 21 59 06 / +228 22 21 27 57